

Le Peuple Basque est sûrement le plus ancien d'Europe. Les anthropologues s'accordent à dire que les Basques d'aujourd'hui sont les descendants directs de l'homme de Cro-Magnon. Son ancienneté remonterait donc à 50.000 ans environ. C'est à des gens qui parlaient l'euskara qu'on doit les peintures de Lascaux et d'Altamira. Le basque est la seule langue non indo-européenne connue en Occident. La toponymie prouve que le basque a été parlé sur un territoire qui va au moins de l'Ebre à la Garonne et au val d'Aran.


Les origines des Basques :
À la lumière des données de
l'anthropologie moléculaire, il semblerait que les Basques se soient
installés en Europe en même temps que les premiers Homo Sapiens
et qu'ils auraient cohabité avec les Hommes de Néanderthal.
Nous serions ainsi les descendants les plus directs des artistes de l'âge
de pierre qui, il y a une vingaine de milliers d'années, ont orné
les parois des grottes de Lascaux et Altamira : les Basques formeraient
donc la population la plus ancienne d'Europe de l'Ouest. Nos traditions
(solidarité ethnique, permanence de cellules familiales, transmission
de biens à un seul héritier) nous auraient permis de conserver
une grande partie du capital génétique ancestral et auraient
ralenti la pénétration de gènes provenant de l'extérieur.
Vers 8500 av JC, différents groupes humains quittèrent la
Mésopotamie à la recherche de nouvelles terres agricoles.
Lorsqu'ils arrivèrent sur les rivages de l'Atlantique vers 4000
av JC, les premiers Basques étaient déjà installés
au pied des Pyrénées, dans une région boisée
au climat doux et humide.
Les études génétiques ont montré que les Européens
de l'Ouest sont génétiquement proches les uns des autres,
à deux exceptions près : les Lapons, d'origine mongole,
et les Basques. Une enquête d'anthropologie moléculaire récente
portant sur plusieurs centaines d'hommes a ainsi mis en évidence
que les Basques :
- ont des groupes sanguins et des marqueurs de
protéines très particuliers, qui se distinguent de ceux
des populations avoisinantes.
- possèdent dans leurs chromosomes une
séquence génétique qui ne se retrouve que dans
une minorité de populations voisines de l'Europe Occidentale.
Ces singularités laissent supposer que les
Basques sont les plus anciens occupants de l'Europe Occidentale. Nous
aurions ainsi résisté mieux que tout autre peuple aux brassages
génétiques qui ont transformé le continent depuis
la "révolution néolithique".
La langue basque, l'Euskara, non indo-européenne, est unique au
milieu des langues parlées dans les environs. Déjà,
Stabon et Jules César la décrivaient comme très différente
de celle des Gaulois. Sa syntaxe et sa structure sont très particulières,
si bien qu'aucun des efforts entrepris pour la relier à d'autres
groupes linguistiques n'a abouti de façon convaincante. Sergeï
Stratostine a rattaché l'Euskara au groupe linguistique du Caucase
du Nord, qui englobe aussi le Sumérien. On a également supposé
que le basque était apparenté à la langue des anciens
Ibères. Mais, en dépit de quelques ressemblances, la maîtrise
du basque ne permet pas de comprendre l'Ibère
Les Basques dans l'Antiquité
:
Les historiens de l'Antiquité répertorient
différents peuples implantés dans le triangle Pyrénées-Garonne-Atlantique
: les Vascons en Navarre, les Varduli en Guipuzcoa et les Caristii en
Biscaye. Dans le dernier millénaire avant JC, la zone d'influence
des premiers basques s'étendait de la Garonne à l'Aragon
et à l'actuelle Biscaye : elle correspondrait à la zone
de transhumance des Pyrénéens occidentaux. Les celtes, qui
envahirent la Gaule vers 500 av JC, ne parvinrent jamais à conquérir
cette zone d'influence. Même si, au tournant de l'ère chrétienne,
une certaine celtisation s'était manifestée par l'introduction
de l'agriculture et du travail du fer en Aquitaine, dans le sud de l'Alava
et de la Navarre, ainsi que dans l'ouest de l'Aragon. Les derniers siècles
avant JC sont également marqués par la construction d'oppidum
sur de hautes collines.
En 72 av JC, Sertorius, le chef romain en Ibérie, se soulève,
avec le soutien des Vascons et des Cantabres, contre Rome et Pompée.
Ce dernier vient assiéger sa capitale. Après sa victoire,
il occupe la Navarre et l'Alava puis fonde la ville de Pampelune. Les
Romains occupaient alors toute la péninsule ibérique. L'une
de leurs plus importante voies, de Bordeaux à Astorga, traversait
le Pays Basque. Ils exploitèrent des gisements de minerais de fer
des Encartaciones (zone la plus occidentale de la Biscaye), ce qui favorisa
le développement des forges dans la zone. Mais les Romains n'ont
jamais pu ou jamais voulu s'installer dans les vallées atlantiques
et du Nord de la Navarre, sans doute intimidés par les montagnes
et les défilés bien défendus par les natifs qui y
habitaient. C'est dans les zones romanisées du pays que commença
la christianisation et la latinisation du Pays Basque.
Dans sa "Guerre des Gaules", César distingue en Gaule
trois zones selon leur langue, leurs coutumes et leurs lois : les Belges,
les Celtes et les Aquitains. Lors des premières expéditions
de César contre les Belges et les Celtes, en 58 av JC, les Aquitains
demeurent simples spectateurs. Mais, en 56 av JC, craignant que César
ne vienne les envahir, ils se préparent à envoyer des renforts
aux Armoricains. César envoya alors un de ses lieutenants, Publius
Crassus, soumettre l'Aquitaine : les Basques sont battus sur les bords
de la Garonne, puis de l'Adour. Finalement, en 39-38 av JC, Agrippa, lieutenant
d'Octave (le futur empereur Auguste), guerroya et vainquit les Aquitains.
C'est à ce moment là que l'influence basque dans les plaines
d'Aquitaine disparût, les populations se latinisant progressivement
à la faveur de l'urbanisation : le Gascon serait ainsi une version
très fortement latinisée de l'Euskara. Les Romains fondèrent
les villes de Lapurdum (Bayonne), Iluro (Oloron), Aquae Tarbellicae (Dax).
L'un des rares vestiges de l'époque romaine en Euskadi, la "pierre
romaine" d'Hasparren indique que les Basques obtinrent leur autonomie
de Rome, grâce aux services rendus à l'Empire par le gouverneur
du pays : la Novempopulanie est créée. La liste de Vérone,
un document daté de 297 et énumérant les provinces
de l'Empire, atteste d'une certaine autonomie de la Novempopulanie.
Le duché
de Vasconie :
En 406, les tribus germaniques envahissent la Gaule.
Elles ravagent la Novempopulanie en 407. L'empereur Honorius concède
aux Wisigoths la Novempopulanie et les régions voisines, avec Toulouse
pour capitale. De religion arienne (hérésie du christiannisme),
ils persécutent les premiers chrétiens qui commencent à
s'implanter au Pays Basque, à la faveur de l'action de San Fermin,
le premier évêque de Pampelune. En 472, ils quittent la Novempopulanie
et installent leur capitale à Tolède en 554. Après
la conversion du roi Reccarède, le concile de Tolède de
589 consacre l'hégémonie des Wisigoths et l'unification
religieuse de la péninsule ibérique. Les Vascons, restés
à l'écart de la romanisation, refluèrent vers le
Nord-Ouest et la Gascogne française sous la pression des Wisigoths.
Wisigoths au sud et Francs au nord tenteront alors, à tour de rôle
et sans y parvenir, de soumettre les peuples de la Novempopulanie. D'après
la chronique de Fégédaire, la tactique des basques consistait
à "former de petits groupes, à harceler l'ennemi par
des escarmouches répétées, à simuler une fuite
au moment opportun et à se retrancher sur des points inaccessibles".
Ainsi, en 635, les Basques repoussent les armées du roi Dagobert,
dirigées par le duc Arimbert, dans la vallée de la Soule.
En 670, les Basques élisent Otsoa pour duc, qui fonde le duché
d'Aquitaine. Celui-ci s'étendait alors jusqu'à la Loire
et intégrait le duché de Vasconie. En 720, Charles Martel
reconnaît la souveraineté d'Odon (Eudes), le fils d'Otsoa,
sur son duché. Et c'est avec son aide qu'il bat les Sarrazins à
Poitiers en 732. Mais, en 760, Charles Martel attaque l'Aquitaine. En
768, Pépin le Bref, fils de Charles Martel et père de Charlemagne,
fait asssassiner le roi d'Aquitaine. Mais, la Vasconie reste indépendante.
Les Musulmans débarquent sur la péninsule ibérique
en 711. Déchirés par les luttes seigneuriales, les Wisigoths
ne pourront s'opposer aux Musulmans : la même année, le roi
Rodrigue est battu à Guadalete. Les Musulmans prennent alors Tolède
et envahissent rapidement la péninsule. En 722, à Covadonga,
la petite troupe de soldats, envoyés de Cordoue par l'émir
Alçama afin de réduire la résistance chrétienne
qui s'est repliée dans les contreforts des Pics d'Europe, est battue.
Cette victoire redonne confiance aux Chrétiens et permet de reconstituer
une monarchie chrétienne aux Asturies.
En 777, après sa victoire contre les Saxons, Charlemagne reçoit
une délégation musulmane d'Espagne conduite par le gouverneur
de Barcelone et de Gérone, en rébellion contre son roi Abd
al Rahman I. Il propose de lui livrer certaines villes du Nord de l'Espagne,
dont Saragosse. Au printemps 778, Charlemagne se dirige vers les Pyrénées
et arrive au pied de Saragosse. Mais le maître des lieux a changé
et refuse de livrer la ville. Charlemagne lève alors le siège
et reprend le chemin de Pampelune avec des otages musulmans, qui seront
libérés par un coup de main à l'entrée de
la Navarre. Par représailles, l'armée de Charlemagne rase
les remparts de Pampelune. Mais, le 15 août 778, au passage des
Pyrénées, dans la région de Ronceveaux, les Basques
tendent une embuscade à l'armée de Charlemagne pour se venger
de cette destruction. Ils tuent la plupart des chevaliers de Charlemagne,
parmi lesquels Roland, ce qui démoralisa les troupes qui battirent
en retraite. Cette bataille restera dans les mémoires grâce
à la Chanson de Roland, écrite dans le courant du XIème
sciècle. En 824, les Basques, alliés aux musulmans, tendent
une seconde embuscade au même endroit contre Louis II le Pieux,
qui revient d'une expédition à Pampelune.
Les deux victoires de Ronceveaux assurent l'indépendance des Basques.
Mais, au nord, la Vasconie est épuisée par 3 siècles
de lutte contre les Francs et le centre de gravité basque se déplace
vers le sud, où naîtra le Royaume de Navarre en 824.
Le royaume basque de Pampelune :
La marche à l'unité (824-1004) :
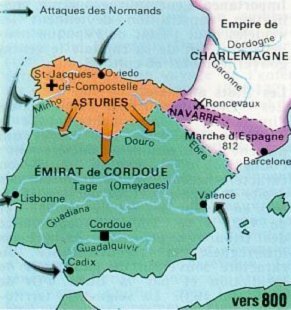
Dans les décennies précédant
la constitution du Royaume de Pampelune, la Navarre était menacée
d'un côté par l'émirat de Cordoue (en 781, Abd el
Rahman I s'était emparé de Pampelune) et de l'autre par
l'empire caroligien. À la fin du VIIIème sciècle,
une alliance politico-familliale s'inaugure entre Inigo Jimenez, le père
du premier roi de Pampelune, et les Banu Qasi, Wisigoths convertis à
l'Islam qui disposaient d'un protectorat dans la région de l'Ebre.
En 801, Louis le Pieux prend Barcelone à l'émir de Cordoue.
En 806, les Navarrais se mettent sous la protection des Carolingiens afin
d'échapper aux forces de l'émirat de Cordoue, venues réduire
les Banu Qasi et leurs alliés Vascons. Il se crée ainsi,
pour un temps, une marche franque en Espagne. Mais, en 812, les Vascons
se révoltent contre les Francs et Louis le Pieux, fils de Charlemagne,
vient à Pampelune rétablir l'ordre. En 824, les Basques
écrasent une seconde fois l'armée franque à Ronceveaux,
alors qu'elle retournait en France après avoir "pacifié"
Pampelune.
Après cette victoire, Eneko Arista est couronné roi de Pampelune.
Dans le Royaume de Pampelune, comme dans les autres royaumes de la péninsule
à cette époque, les souverains n'ont pas une autorité
absolue sur leur sujets. La noblesse disposait de privilèges importants,
défendus avec âpreté : ce sont eux qui dans la pratique
dominaient les vallées, recouvraient des impôts, exploitaient
les terres... Les représentants du peuple se réunissent
en assemblées provinciales (les Cortes), dans lesquelles le souverain
vient prêter serment de respecter les Fors (statuts, franchises
et libertés de chaque village).
En 842, l'émir de Cordoue, Abd el Rahman II, bat les Banu Qasi
et Eneko Arista. Le royaume de Pampelune mènera alors, dans le
courant du IXème sciècle, une politique mêlant résistance
et entente avec les Arabes afin de préserver sa souveraineté.
Au cours du Xème sciècle, les rois successifs organisent
et renforcent le Royaume, tout en repoussant les musulmans au Sud et les
Vikings au Nord. En 925, le roi de Navarre Garcia Sanchez I épouse
la princesse aragone Andregoto Galindez. Leur fils, Sancho Abarca, réunira
en 970 l'Aragon au royaume de Pampelune. En 998 et 999, l'émir
de Cordoue Almanzor, au zénith de sa puissance, ravage Pampelune.
Mais, il meurt à la bataille de Calatañazor en 1002, vaincu
par l'alliance entre la Navarre et la Castille.
L'apogée de la Navarre (1004-1076) :

C'est sous le règne de Sanche
le Grand que la Navarre connaît son apogée. Né en
992, il épouse Munia, la fille du comte de Castille en 1016. Il
établit une alliance objective avec le comte de Barcelone, et prend
ainsi contact avec les cultures religieuses françaises. Il étend
également son influence sur la Gascogne et le comté de Toulouse,
grâce à ses relations familliales avec le Roi de Gascogne
(la fille du roi de Navarre Garcia Sanchez I, avait épousé
le Roi de Gascogne), qui lui prêtera serment en 1012, après
l'avoir refusé à Hugues Capet. Le 13 mai 1029, le jeune
comte de Castille, venu en Léon épouser la fille du comte,
est assassiné. La Castille revient alors à Munia, la femme
de Sancho. Le règne de Sanche le Grand est, pour le royaume de
Pampelune, une époque d'expansion politique, économique
et sociale. C'est pendant son règne que le danger arabe quitte
définitivement la Navarre, en partie à cause de la grande
guerre civile arabe (1008-1028) qui met fin califat des Omeyyades.
Lorsque Sancho le Grand meurt en 1035, ses possessions se partagent entre
ses fils : l'aîné Garcia, le seul roi au départ, aura
autorité sur les provinces basques, Ferdinand sera comte de Castille,
et par mariage, de Léon, tandis que Ramiro héritera de l'Aragon.
Progressivement au cours du XIème sciècle, la Castille lorgne
sur la Navarre. C'est ainsi que le 1er septembre 1054, les troupes de
Ferdinand de Castille tuent Garcia à la bataille d'Atapuerca. En
1067, avec l'aide du roi d'Aragon, la Navarre repoussent les Castillans
à Viana. Mais, le 4 juin 1076, le roi de Navarre est assassiné
et le roi de Castille en profite pour envahir la Navarre.
Le déclin de la Navarre (1076-1425)
:
Les navarrais choisissent alors le Roi d'Aragon
comme souverain et ils chassent ensemble les castillans. À l'issue
de la bataille, le royaume de Pampelune passe sous la protection du Roi
d'Aragon, qui nomma un Comte de Navarre. La Rioja est absorbée
par la Castille. Et pendant 58 ans, de 1076 à 1134, la Navarre
jouira d'une souveraineté relative et partagée, sous l'administration
de l'Aragon. Pendant cet intermède, les navarrais et les aragonais
prendront successivement Huesca (1096), Tudela (1119) et Saragosse (1118)
aux Arabes.
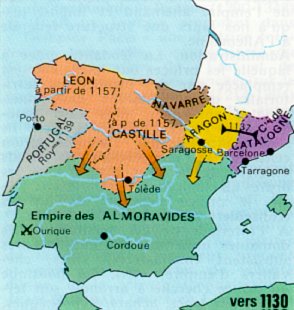
En 1134, le Roi d'Aragon et de Navarre
meurt sans descendance à la bataille de Fraga. Il lègue
par testament son royaume aux ordres du Temple, de l'Hôpital et
du Saint-Sépulcre. Refusant le testament, les Cortes de Navarre
et d'Aragon choississent chacun leur propre Roi : l'Aragon et la Navarre
se séparent.
En 1200, alors que le roi de Navarre Sanche le Fort est en expédition
en Afrique, la Castille et l'Aragon envahissent la Navarre. À l'issue
du conflit, la Castille prend l'Alava, le Guipuzcoa et la Biscaye, avec
le soutien des seigneurs basques. Le roi de Castille devient seigneur
du Guipuzcoa. En échange de leur collaboration, Alava, Guipuzcoa
et Biscaye bénéficieront chacune de Fors très libéraux
qui feront d'elles des états associés par le lien personnel
au souverain de Castille, mais pas des provinces de Castille. La Navarre
est réduite à la portion congrue.
L'Alava et la Biscaye, passées sous la coupe de la Castille virent
se dynamiser leurs économies. Ainsi, Vitoria, fondée en
1181 par Sanche le Sage, deviendra une place commerciale qui fut pendant
des siècles le principal marché basque et le siège
d'une communauté dynamique de commerçants et d'artisans,
où la communauté juive joua un rôle fondamental. Bilbao
fut fondé au XIVème siècle par les rois castillans.
De part sa situation géographique privilégiée pour
la création d'un port maritime, la ville devint l'accès
vers l'Europe des produits de la Castille. L'essor commercial favorisa
l'exportation du fer des forges biscayennes et dynamisa l'activité
maritime des villages côtiers voisins. En revanche, du fait de leur
conditions orographiques, de vastes zones du Guipuzcoa vécurent
isolées de leur milieu. Leur rapports avec l'extérieur se
limitant aux zones proches des principales voies de communication, utilisées
pour le commerce et par les pèlerins qui faisaient le chemin de
Saint Jacques de Compostelle.
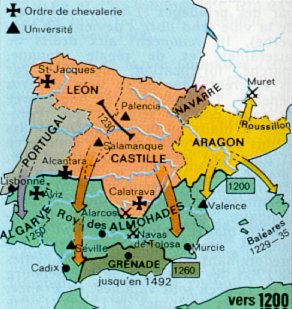
Le 14 octobre 1201, à Chinon,
la Navarre signe une paix pepétuelle avec l'Angleterre, devenue
maîtresse de la Gascogne après le mariage d'Aliénor
d'Aquitaine avec Henri II d'Angleterre. Cela permit à la Navarre
de récupérer, à Bayonne, l'usage d'un port maritime.
Sous l'insistence du pape et malgré leurs différents, la
Navarre s'allie à la Castille pour battre les Arabes à las
Navas de Tolosa en 1211. En 1234, à la mort du roi de Navarre,
le royaume échoue à son neveu Thibault IV de Champagne,
qui sera un souverain pacifique et favorisera le développement
de l'agriculture en introduisant les techniques de son pays.
Dans les années 1270, des luttes éclatent entre les divers
bourgs (navarrais, français, ...) de Pampelune. Ils atteindront
leur paroxysme avec la guerre civile de Pampelune (1274-1276). En 1284,
la reine Jeanne épouse Philippe IV le Bel, roi de France : la Navarre
passe alors, jusqu'en 1328, de la maison de Champagne à celle de
France. À la mort de Charles IV en 1328, le parlement de Navarre
choisit Jeanne, fille de Louis X le Hutin et mariée au comte d'Evreux,
pour reine. Son fils, Charles le Mauvais (1349-1387) se mêlera beaucoup
de politique française et s'attirera la haine de Jean II le Bon,
pour avoir fait assassiner le connétable de France (1354) afin
d'obtenir la dot de sa femme. Le roi de France le fera emprisonner de
1356 à 1357, mais il finira par s'évader. Il s'alliat alors
avec les Anglais pour combattre la France. De 1363 à 1367, les
intrigues et les guerres entre Henri de Trastamare, qui voulait s'emparer
du trône de Castille, et les rois de France et d'Aragon d'une part,
et les rois de Castille, de Navarre, d'Angleterre d'autre part, se succèdent.
Elles se termineront par la déroute d'Henri de Trastamare à
la bataille de Najera. En 1372, par jugement, le pape attribue l'Alava,
le Guipuzcoa et la Rioja à la Castille et propose le mariage de
l'infant de Navarre à la princesse de Castille pour assurer la
paix entre les deux royaumes. Le 31 mai 1379, le roi de Navarre devra
accepter, après l'enlèvement de son fils par Charles V,
la paix de Briones où il renonce aux alliances avec l'Angleterre.
Son fils Charles III le Noble finira par rétablir la paix interne
et externe.
La guerre civile (1425-1515) :
Lorsque Charles le Noble meurt, le trône revient
à sa fille Jeanne et à son mari Jean d'Aragon. À
sa mort (1441), Jeanne lègue son royaume à son fils le Prince
de Viana. Mais Jean d'Aragon occupe le trône. En 1447, il se remarie
avec Juana Enriquez dont il aura un fils : Ferdinand d'Aragon. Lorsque
le 7 septembre 1451, le Prince de Viana met fin, par le traité
de Puente la Reina, à la guerre initiée par son père
contre la Castille, celui-ci lui envoie Juana Enriquez comme régente.
La noblesse de Navarre se divise alors en deux : l'un suit Louis de Beaumont,
partisant du Prince de Viana et de l'amitié avec la Castille, l'autre
celui des Gramont, favorable à Jean et à l'Aragon. En 1452,
c'est la guerre ouverte. Le 3 décembre 1454, à Barcelone,
en présence de leur soeur Leonore et de son mari Gaston IV de Foix,
Jean somme le Prince de Viana et sa soeur Blanche de se soumettre, faute
de quoi ils subiraient un procès destiné à les priver
de leurs droits héréditaires au royaume. En avril 1456,
ils se soumettent et la Navarre est transférée à
Léonore. Gaston de Foix vient, pendant l'été 1456,
en Navarre faire appliquer la décision.
En 1458, à la mort de son frère, Jean hérite de l'Aragon,
de Valence et de la Catalogne. Le Prince Viana et sa soeur Blanche meurent
respectivement en 1461 et 1464. Jean d'Aragon conserve toujours le pouvoir,
et malgré les promesses de 1456, Léonor et Gaston IV de
Foix devront attendre leur tour, en 1479. Ils continueront malgré
tout à le servir fidèlement. Et pendant ce temps, les deux
factions, Beuamontais et Agramontais, s'entretuent : seule la Basse Navarre
échappe à la guerre civile. François Phoebus, fils
d'Eléonor de Navarre et de Gaston IV de Foix-Béarn est reconnu
roi par les deux parties en 1481, mais son pouvoir est affaibli. La reine-mère
et Ferdinand d'Aragon, devenu entre temps roi de Castille et d'Aragon,
finissent par imposer temporairement la paix aux deux parties en partageant
entre eux les charges du royaume. À la mort de François
(1483), sa soeur Catherine hérite du trône et épouse
Jean d'Albret, seigneur de Foix, de Comminges et de Béarn. La guerre
civile reprend : elle ne s'achèvera que par l'invasion de la Navarre
par la Castille en 1512. Les souverains de Navarre résideront désormais
à Pau, en Béarn.
La fin du royaume de Navarre :
Le 18 juillet 1512, une armée castillane
dirigée par le duc d'Albe franchit la frontière navarraise.
Le 21, elle assiège Pampelune, qui se rend le 25. Une autre armée,
en provenance de l'Aragon et commandée par l'évêque
de Saragosse, occupe le sud de la Navarre, qui résistera jusqu'en
septembre. Pendant l'été, l'armée du duc d'Albe envahit
la Basse Navarre. Louis XII monte alors une expédition, confiée
au dauphin François et à laquelle participe Jean d'Albret,
pour libérer la Navarre. Elle met le siège devant Pampelune
le 27 novembre, mais tourne court avec l'arrivée de l'hiver.
En juillet 1515, le Roi Ferdinand annexe officiellement la Navarre à
ce qui est devenu le Royaume d'Espagne, tout en promettant de lui conserver
ses Fors et ses coutumes et en lui assurant une relative autonomie : le
roi serait représenté en Navarre par un vice-roi et agirait
par l'intermédiaire d'un Conseil Royal. En 1521, profitant de la
révolte des Communéros, le roi Henri d'Albret, aidé
par la France, attaque à nouveau les espagnols. Le 15 mai 1521,
ils s'emparent du château de St Jean Pied de Pord et reprennent
le contrôle de la Basse Navarre. Ils arrivent à Pampelune
où la population s'est révoltée contre les espagnols
: la ville tombe le 20 mai. Mais, après avoir vaincu les Communeros,
l'armée espagnole se retourne contre les armées franco-navarraises,
qu'elle bat le 30 juin à Noain, dans le bassin de Pampelune. Elle
reprend le contrôle de la Navarre, à l'exception de la Basse
Navarre.
En 1531, la jugeant trop difficile à défendre, Charles Quint
renonce à ses droits politiques sur la Basse Navarre. Ce reliquat
du royaume de Navarre intègrera finalement celui de France en 1589
lorsque son roi, Henri III de Navarre, sera couronné roi de France
sous le nom d'Henri IV. Mais, c'est son fils, Louis XIII, qui unira définitivement
les deux royaumes en 1620.
Contrairement aux croyances, ces deux provinces basques n'ont jamais formé d'entité unique avec les 5 autres : elles ont durant tout le Moyen-Âge fait partie intégrante du duché d'Aquitaine.
En 843, par le traité de Verdun, l'Empire de Charlemagne est divisé en 3 et l'Aquitaine est intégrée au royaume franc occidental. Mais ce royaume se disloque avec l'invasion des Vikings, qui occupent Bayonne en 892. Ils éxécutent Saint-Léon venu évangéliser la région. Après leur départ, un comté indépendant se forme englobant la Gascogne, dans laquelle se retrouvent la Soule et le Labourd. En 987, la Gascogne refuse son hommage à Hugues Capet. Elle rendra hommage au Roi de Navarre, ce qui fera dire à certains que le roi de Navarre reignait alors sur la Gascogne. Mais, ce duché ne sera jamais intégré au royaume de Navarre.
En 1137, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, se marie avec le Roi de France Louis VII et lui apporte en dot ses possessions. En 1152, elle divorce et se remarie avec Henri Plantagenet, qui deviendra roi d'Angleterre en 1154 sous le nom d'Henri II : la Soule et le Labourd, tout comme le Poitou, la Guyenne et le reste de la Gascogne, passent de la couronne française à la couronne anglaise. C'est ainsi qu'en 1174, Richard Coeur de Lion viendra réduire le vicomte du Labourd Arnaud Bertrand, qui s'était soulevé avec ses barons basques. Les rois d'Angleterre séparent alors Bayonne du Labourd et s'appuient sur la bourgeoisie gascone afin d'administrer ce port si utile à leur commerce et à leur flotte de guerre. En 1259, par le traité de Paris, le roi d'Angleterre Henri III renonce à l'Anjou, au Maine et au Poitou et reconnaît la suzeraineté du roi de France sur l'Aquitaine (Cf. carte ci-dessous).

En août 1343, le peuple du
Labourd se soulève contre le maire de Bayonne, qui avait fait massacrer
5 chefs labourdins, et assiège la ville. Il s'ensuit une longue
guerre civile entre Bayonne et le Labourd. Le Prince Edouard de Galles,
dit aussi Prince Noir, imposera finalement la paix en avril 1357 et condamnera
les notables de Bayonne à dédommager les Labourdins. En
1360, après sa défaite à Poitiers (1359), le Roi
de France Jean II le Bon abandonne sa suzeraineté sur l'Aquitaine
lors du traité de Brétigny.
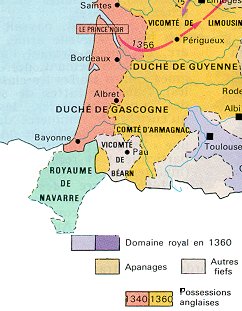
Le Pays Basque Nord et ses environs au XIVème sciècle
Pendant la Guerre de Cent Ans, les basques de Labourd et de Soule, sujets britanniques se battront contre les Français. Ainsi, en 1449, ils résisteront à Gaston de Foix, vicomte de Béarn. Le Roi de Navarre, suzerain du château de Mauléon et gendre de Gaston de Foix, parlemente et fait basculer la Soule dans le giron du Béarn. En 1450, Gaston de Foix s'attaque au Labourd et remporte les combats de Guiche et Saint Pée sur Nivelle. Le Labourd finit par conclure la paix avec le Roi de France lors du traité d'Ayherre : il intègre le Royaume de France mais conserve ses Fors. En 1451, Dunois et Gaston de Foix assiègent Bayonne, qui finit par se rendre en échange de la conservation des franchises municipales. En 1510, la Soule est rattachée à la Couronne de France.


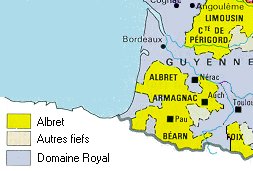
Le
Pays Basque de la Renaissance à la Guerre d'Espagne :
Au début du 16ème siècle,
les provinces basques n'ont plus aucun lien politique entre elles. Mais
elles gardent une relative autonomie interne :
- elles lèvent leurs impôts et ne le versent pas au roi.
- elles organisent leurs propres milices et ne sont pas soumis au devoir
militaire au-delà des limites de leur territoire.
- le servage y est inconnu.
- les libertés sont garanties par des coutumes écrites
(les Fors) et par les assemblées populaires locales.
Mais si elles étaient théoriquement libres de se séparer
du Roi, le caractère absolu des monarchies limitait dans la pratique
cette liberté.
Lors du traité des Pyrénées (1659), l'Espagne et
la France mettent fin à de longues années de conflit et
concluent le mariage de l'infante Marie-Thérèse d'Espagne
avec le Roi Louis XIV, qui aura lieu à Saint Jean de Luz en 1660.
Le Roi de France renonce définitivement à ses droits héréditaires
sur le royaume de Navarre et la France reçoit le Roussillon,
la Cerdagne, l'Artois, une partie du Luxembourg et quelques places fortes
des Flandres. Ce traité fige définitivement la frontière
entre les deux pays et, depuis lors, l'histoire du Pays Basque se confond
avec celle des états dans lesquels il est intégré.
Le
Pays Basque Nord :
En passant de la tutelle anglaise à la
tutelle française, Bayonne connaîtra une période
de marasme et de décadence économique dont elle ne sortira
lentement qu'à partir de 1580. Elle ne redeviendra florissante
qu'à la fin du XVIIIème siècle. Pendant le XVIIème
et le début du XVIIIème siècle, c'est Saint Jean
de Luz qui tiendra le haut du pavé économique : chaque
année, 7000 labourdins s'embarquent pour la pêche à
la morue vers Terre-Neuve.
Parmi les évènements marquants du Pays Basque Nord sous
l'Ancien régime, on relèvera :
- le procès de sorcellerie de Saint Pée, ouvert en 1609
par un représentant du roi : plusieurs prêtres et 700 femmes
sont envoyés au bûcher. Seule l'intervention de l'évêque
de Baïgorri auprès d'Henri IV permit l'arrêt du massacre.
- l'édit d'union qui rattache en 1620 le royaume de Navarre à
la couronne de France, malgré l'opposion de l'assemblée
navarraise. La monnaie navarraise sera supprimée en 1643.
- les fréquentes révoltes, réprimées dans
le sang, contre la centralisation monarchique : en 1641 contre l'installation
des Fermiers Généraux, en 1661, en 1685 contre la gabelle
à Saint Jean Pied de Port, puis en 1696, en 1724, en 1726 et
en 1748. La dernière a lieu à Hasparren du 3 au 6 octobre
1784 : plusieurs centaines de femmes tiennent tête à 150
grenadiers et 5 brigades de la maraîchaussée et protestent
contre l'extension de la gabelle. Seule l'intervention du curé
évitera la bataille.
- en 1707, le français devient la seule langue officielle dans
les 3 provinces du Nord.
La Révolution française met fin à l'autonomie relative
des provinces basques. En 1789, la Constituante, malgré les protestations
des députés basques, supprime l'autonomie de la Soule
et du Labourd et annexe la Navarre à la France. En 1790, le département
des Basses Pyrénées est créé, malgré
l'opposition conjointe des représentants basques et béarnais
qui réclament deux département distincts. En 1793, à
la mort de Louis XVI, l'Espagne déclare la guerre à la
France révolutionnaire. En 1794, 4000 basques du Labourd sont
déportés dans le Gers et dans les Landes pour avoir refusé
de combattre contre les Basques du Sud. En 1795, le traité de
Bâle met fin aux hostilités entre les deux pays : l'Espagne
cède à la France la partie espagnole de l'île de
Saint Domingue. La création, en 1800, de l'institution préfectorale
par Bonaparte accélère la centralisation.
Au cours du XIXème sciècle, le Pays Basque Nord restera
en marge de l'industrialisation, du fait de son manque de matières
premières et de sa situation périphérique. Son
économie demeurera essentiellement agricole et artisanale. La
société traditionnelle, aux connaissances transmises par
la tradition orale, fortement structurée sur la maison et la
paroisse, hiérarchisée autour des prêtres et des
notables, demeurera longtemps le modèle de société
des basques du Nord. Le transfert, en 1841, de la douane espagnole de
l'Ebre aux Pyrénées détruit la structure économique
du Pays Basque Nord. Ses habitants vont alors, à partir de 1845,
massivement émigrer vers les Amériques : 90 000 personnes
quitteront le Pays Basque au cours du XIXème siècle. Cette
émigration sera en grande partie compensée par une forte
natalité.
Sous la IIIème République, les Instituteurs chercheront
à franciser la société, générant
une impression d'insécurité face à l'intrusion
d'une culture véhiculant des modes de pensée différents
de ceux de la société basque traditionnelle. Celle-ci
s'isolera et constituera des barrières autour des instituteurs
et des ouvriers venus de l'extérieur, les excluant de la vie
locale.
Le Pays Basque Nord participera à toutes les guerres franco-allemandes
en envoyant des combattants au front. Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, les Basques joueront même un rôle prépondérant
dans le passage de la frontière pour les juifs en fuite et les
aviateurs alliés abbatus.
Le Pays Basque Sud
:
Les provinces du Sud, et en particulier les zones
côtières de Biscaye et de Guipuzcoa, profitent de la colonisation
des Amériques, qui favorise le développement de la navigation,
du commerce et de l'industrie artisanale (en particulier les forges).
Les régions basques du sud ont donc bénéficié
de circonstances économiques plus favorables que celles du Nord,
coupées du Canada et de Terre Neuve par les guerres contre les
Anglais. Cet essor économique s'accompagne également d'un
essor démographique : les 4 provinces du Sud voient leur population
passer de 350 750 en 1560 à 515 400 en 1800. Ce développement
a également été permis par un centralisme plus
tardif de l'état espagnol. Mais, en dépit des Fors qu'ils
juraient de respecter, les Rois d'Espagne ont également manifesté
une volonté centralisatrice. Au début du XVIIème
siècle, ils décrètent ainsi que les membres des
assemblées de Guipuzcoa et de Biscaye doivent maîtriser
le castillan et que les notaires doivent dresser leurs actes officiels
en castillan. Le Pays Basque Sud connaîtra aussi ses révoltes,
durement et violemment réprimées : révoltes du
sel en 1631 et 1634, révoltes des paysans en 1718 et en 1804.
En 1700, le roi d'Espagne meurt sans descendance et choisit par testament
Philippe d'Anjou, le petit fils de Louis XIV et oncle du futur Louis
XV. La guerre de succession d'Espagne éclate alors entre la France
d'une part et la Grande alliance réunissant l'Angleterre, le
Saint Empire, la Prusse, le Danemark et les Provinces Unies d'autre
part. Cette guerre s'achèvera par le traité d'Utrecht
(11 avril 1713) dans lequel Philippe d'Anjou est reconnu souverain d'Espagne
et de ses colonnies. Gibraltar et Minorque sont cédées
à l'Angleterre et le tracé de la frontière franco-espagnole
est confirmée. L'Espagne perd également le Luxembourg
et les Flandres, ses possessions en Italie, ainsi que la Sicile et la
Sardaigne.
En 1807, Napoléon obtient du roi d'Espagne l'autorisation de
faire passer ses troupes sur le territoire espagnol en direction du
Portugal, favorable aux Anglais. Mais l'installation des troupes françaises
au Nord inquiète les habitants et le premier ministre Godoy conseille
aux souverains de se réfugier aux Amériques, comme l'ont
fait les souverains portugais. Dans la nuit du 17 mars 1808, le palais
de Godoy à Aranjuez est attaqué par les partisans du prince
héritier Fernando. Carlos IV destitue Godoy en abdiquant en faveur
de son fils. En réponse, Napoléon convoque à Bayonne
Fernando et son père et les oblige à renoncer au trône
d'Espagne (5 mai). Il les interne et nomme son frère Joseph roi
d'Espagne.
Mais ces négociations et la présence des troupes françaises
à Madrid mécontentent le peuple. La révolte du
2 mai 1808 à Madrid marque le début de la guerre d'indépendance
espagnole. L'armée française commet alors des exactions,
qui poussent la Diputacion Forale de Navarre à déclarer
la guerre à Napoléon le 29 août : elle mobilise
les hommes de 17 à 40 ans. Cette guerre sera une guerre de guérilla,
qui finira par chasser Napoléon avec la participation des Anglais
de Wellington. En 1813, plusieurs colonies américaines profitent
de la guerre pour conquérir leur indépendance : la Plata,
Uruguay, Paraguay, Chili, Colombie. Cette guerre aura des conséquences
importantes sur le devenir des provinces basques : le centralisme français
contamine l'Espagne tandis que la dictature et l'irreligiosité
de Napoléon rendent odieuses à la majorité des
Basques les idées de la Révolution Française.
La constitution de Cadix, rédigée par les libéraux
en 1812, sous le règne de Joseph Bonaparte, apparaît aux
Basques comme contraire à leur lois (car ils considèrent
leurs Fors comme un don de Dieu) et ils se sentent menacés. En
1814, Fernando VII est libéré par Napoléon. Revenu
au pouvoir, il abrogera cette constitution et règnera en monarque
absolu. Au XIXème sciècle, la majorité des Basques
prendra partie pour les absolutistes espagnols, qui veulent conserver
la monarchie et les Fors et qui sauront flatter le goût d'indépendance
et le catholicisme des Basques, contre les Libéraux. Mais, en
1820, les Libéraux l'emportent et menacent les libertés
basques, les considérant comme des privilèges provinciaux
octroyés par le souverain espagnol. Don Carlos, prétendant
à la succession de son frère Fernando VII, prend la défense
des Fors.
À la mort de Fernando VII, Don Carlos est évincé
du trône par sa nièce Isabelle, qui représente la
tendance libérale. Il lève alors l'étandard de
la révolte : c'est le début de la première guerre
carliste. Les bataillons carlistes, essentiellement basques, s'organisent
au cri de "vive les Fors", sous la direction du général
en chef Tomas Zumalakarregui. Avec ses 27000 hommes, par une tactique
de guérilla et d'embuscades, il tient en échec 105 000
hommes de l'armée espagnole et parvient à prendre plusieurs
places fortes du Pays Basque. Mais, il meurt en 1835 après avoir
été blessé par balle en voulant prendre Bilbao.
Après la mort de Zumalakarregui, l'armée carliste subit
défaites sur défaites. Elle sera reprise en main par le
général Maroto, qui finira par se rendre au général
libéral Espartero lors de "l'abrazo" de Vergara le
31 août 1839. La guerre fit 270 000 morts. Don Carlos est interné
à Bourges par Louis Philippe. À sa mort en 1860, il transmettra
ses droits à son fils, qui les retransmettra à son propre
fils Don Carlos VIII en 1868.
La Navarre est transformée en province et perd son statut de
royaume. Les trois autres provinces basques perdent la plupart de leurs
privilèges foraux. En 1841, la douane espagnole est transferée
de l'Ebre aux Pyrénnées et à la Bidassoa. Les 4
provinces s'espagnolisent progressivement. L'industrialisation de la
Biscaye puis du Guipuzcoa transforme leurs infrastructures. Grâce
à la machine à vapeur et aux minerais voisins des Encartaciones,
la métallurgie lourde se développe.
En 1872, les provinces basques se soulèvent en faveur de Don
Carlos VIII. La deuxième guerre carliste se solde par la défaite
de Don Carlos VIII en février 1876. Les provinces basques perdent
alors définitivement leurs Fors.
À la fin du XIXème siècle, le nationalisme basque
prend une forme nouvelle. Sabino Arana Goiri dessine l'Ikuriña
en 1893, fonde le Parti National Basque (PNB) en 1895 et crée
un hymne national basque. Il est aussi l'auteur d'une abondante littérature
politique qui inspirera les nationalistes basques du XXème siècle.
Dans les premières décennies du siècle, le PNB
devient la principale force politique des 4 provinces du sud.
De 1923 à 1931, l'Espagne d'Alphonse XIII vivra sous la dictature
des généraux Miguel Primo de Riveira et Berenguer.
Le Pays Basque Sud pendant la Guerre d'Espagne et la dictature franquiste :
En 1931, les élections municipales
espagnoles donnent, dans les villes, une forte majorité aux républicains.
Alphonse XIII s'exile après avoir abdiqué : en juin, la
république est proclamée et une assemblée constituante
est élue. Les provinces basques envoient aux Cortes une majorité
de députés issus du PNB, parmi lesquels Aguirre. La consitution
adoptée en décembre autorise l'autonomie des régions
à condition que l'autonomie soit adoptée par 2/3 des maires,
approuvée par référendum par au moins 70% des électeurs
et approuvée par les Cortes. La Catalogne et le Pays Basque finiront
par réunir ces 3 conditions. Ainsi, dans les 3 provinces d'Alava,
de Guipuzcoa et de Biscaye, 80% des participants au référendum
adoptent l'autonomie. En revanche, la Navarre la refusera. La constitution
prononce également des mesures violemment anti-cléricales.
En 1933, José Antonio Primo de Riveira, fils du dictateur, fonde
la Phalange : ce mouvement est hostile à tout séparatisme
local.
En février 1936, le Frente Popular est vainqueur aux élections.
Le 13 juillet 1936, le leader monarchiste Calvo Sotelo est assassiné
par les républicains. Pour rétablir l'ordre dans le pays,
les militaires forment alors le "soulèvement national"
(18 juillet) mais le gouvernement proclame la résistance : c'est
le début de la Guerre d'Espagne. Les garnisons se révoltent
: celles de Bilbao et de San Sebastian sont maîtrisées
par les nationalistes basques. Le Movimiento, qui s'appuie alors sur
l'Église prend bientôt les allures d'une croisade.
Parti du Maroc sur des bateaux allemands et italiens, le général
Franco dirige les opérations dans le Sud alors que le général
Mola, en accord avec Franco, s'est révolté en Navarre.
Ainsi, en octobre, 10% de la population navarraise se retrouvera dans
les rangs de l'armée franquiste. Franco fait sa jonction au mois
d'août avec l'armée du Nord près de Madrid. Les
basques sont alors coupés du gouvernement républicain.
Après la prise d'Irun par le général Mola, le 15
septembre, à la suite de combats qui dureront 3 semaines, ils
seront coupés du Pays Basque Nord et les républicains
sont empêchés de communiquer par le Nord via la France.
San Sébastien tombe le 13 septembre, puis vient le tour du reste
du Guipuzcoa. Le 27 septembre, Bilbao repousse les armées franquistes.
Le 1er octobre 1936, à Burgos, Franco est nommé généralissime
et chef de l'état.
C'est alors que le gouvernement républicain espagnol reconnaît
l'autonomie des 3 provinces basques. Le 7 octobre 1936, Aguirre forme
à Guernica le premier gouvernement d'Euskadi et prête serment
sous le chêne millénaire. Mais ce gouvernement n'a aucune
juridiction sur la Navarre et les franquistes occupent la majeure partie
de l'Alava et du Guipuzcoa. Malgré tout, il tiendra tête
aux armées franquistes pendant près d'un an. Il exerera
un pouvoir démocratique et réorientera l'économie
dans l'industrie de guerre. Le 31 mars 1937, les franquistes attaquent
avec l'appui aérien de la légion Condor. Le 26 avril,
l'aviation allemande détruit la ville et la population de Guernica.
Bilbao finira par tomber le 19 juin, après 10 semaines de résistance
acharnée.
Après la chute du Pays Basque, les hommes de l'armée d'Euskadi
participeront à la défense de Santander, mais finiront
par se rendre aux Italiens. Seuls une petite partie d'entre eux parviendra
à fuir, parmi lesquels Aguirre. Barcelone tombe le 26 janvier
1939, Madrid et Valence tomberont les 28 et 30 mars, mettant fin à
la guerre d'Espagne par la victoire de Franco.
Pendant la deuxième guerre mondiale, le gouvernement basque se
réfugie à New York. La paix revenue, il s'installe à
Paris, dans l'actuelle Maison des Basques de Paris, où Aguirre
meurt en 1960. Pendant la dictature franquiste, les grèves de
1947 et 1951 sont sévèrement réprimées.
Certains nationalistes basques décident alors d'utiliser l'action
terrorriste pour lutter contre Franco et créent l'ETA (Euskadi
Ta Askatasuna : Pays Basque et liberté) en 1959. Progressivement,
l'ETA s'implante au coeur de la société basque des provinces
du Sud en organisant diverses manifestations politiques hostiles au
franquisme. Il assassine un certain nombre de personnalités ou
de membres des forces de police et de l'armée, parmi lesquelles
le général Carrero Blanco, chef du gouvernement de Franco
(20 décembre 1973). L'ETA fera également parler de lui
lors du procès de certains de ses membres à Burgos en
décembre 1970, en enlevant le consul allemand de San Sebastien.
Franco meurt en 1975. En 1978, une nouvelle constitution entérine
le passage de l'Espagne à la démocratie, sous la forme
d'une monarchie parlementaire. Les trois provinces de l'Alava, de Biscaye
et de Guipuzcoa obtiennent en 1979 un statut d'autonomie particulier.